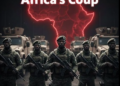Introduction
Dans de nombreux pays africains, dont le Ghana, les ressources naturelles telles que les forêts, les plans d’eau, les terres agricoles et les pêcheries sont importantes pour la subsistance de millions de personnes (Adom, Reid, Afuye & Simatele, 2024 ; Baafi, 2024). Cependant, la gestion de ces ressources est devenue de plus en plus difficile à mesure que la demande augmente en raison de la croissance démographique, de l’urbanisation et des pressions économiques (voir Agyare, Holbech, & Arcilla, 2024 ; Puplampu & Boafo, 2021 ; Takyi et al., 2021). Le concept de « tragédie des biens communs », imaginé en 1833 par l’écrivain britannique William Forster Lloyd mais popularisé par l’écologiste et philosophe américain Garrett Hardin en 1968, offre un cadre permettant de comprendre comment des individus, agissant dans leur propre intérêt, peuvent par inadvertance épuiser des ressources partagées, ce qui entraîne un préjudice collectif à long terme.
La théorie de Hardin suggère que lorsque les ressources sont détenues en commun ou partagées par un groupe d’individus sans qu’il y ait de propriété claire, il est possible que chaque individu surutilise la ressource en question, ce qui entraîne son épuisement. Ce cadre analytique reste très important pour les défis de gestion des ressources auxquels le Ghana est confronté aujourd’hui, où des problèmes tels que la surpêche, la déforestation et l’exploitation minière illégale (connue localement sous le nom de Galamsey) ont atteint des niveaux critiques. Cet article revisite la théorie de la tragédie des biens communs de Hardin et l’applique aux problèmes actuels de gestion des ressources du Ghana, tout en proposant des solutions potentielles.
Comprendre la tragédie des biens communs dans le contexte ghanéen
Garret Hardin (1915-2003) était un biologiste bien connu, notamment pour ses travaux sur l’évolution et la sélection naturelle (Frischmann, Marciano et Ramello, 2019). Dans ses travaux universitaires et non universitaires, Hardin a insisté sur la nécessité de contrôler la population. Dans son article de 1968, qu’il a écrit principalement pour mettre en garde contre les dangers de la surpopulation, il a appliqué le terme « biens communs » à une grande variété de scénarios dans lesquels une ressource est ouverte à tous, avec peu de contraintes sur l’utilisation de la ressource. L’argument central de Hardin dans la Tragédie des biens communs est que lorsque les ressources sont partagées par un groupe, les membres du groupe agissant par intérêt personnel vont souvent surutiliser ou épuiser ces ressources, ce qui entraîne une dégradation de l’environnement. Il a utilisé l’exemple de William Forster Lloyd d’un pâturage partagé par plusieurs bergers, où chacun cherche à maximiser son propre bénéfice en augmentant son cheptel. Si chaque éleveur tire un petit profit de ses animaux supplémentaires, l’effet cumulatif de l’augmentation du nombre d’animaux par tous les éleveurs entraîne la dégradation du pâturage, ce qui nuit à tout le monde à long terme. Selon lui, dans ce scénario, chaque individu a tendance à utiliser la ressource pour maximiser son propre intérêt immédiat tout en négligeant l’investissement ou l’effort qui pourrait conserver la ressource pour d’autres ou pour un usage commun futur.
Selon la thèse de Hardin, chaque individu calcule rationnellement qu’il peut tirer tout le profit de sa propre utilisation de la ressource commune tout en partageant les pertes avec tous les autres utilisateurs. La tragédie survient parce que, selon le même raisonnement, tous les utilisateurs épuisent collectivement le bien commun. Hardin utilise la description de l’état de nature de Thomas Hobbes pour expliquer un phénomène similaire dans la situation des biens communs. Hobbes affirme qu’en l’absence d’un pouvoir central capable d’imposer des lois et de l’ordre, les individus dans l’état de nature se comporteraient sur la base de l’auto-préservation, guidés par leurs propres désirs, et qu’il y aurait une guerre et une insécurité perpétuelles (Navari, 1996 ; Read, 1991 ; Sadler, 2010). De la même manière, dans l’exemple des biens communs, en l’absence d’un organe de gouvernance pour en contrôler l’utilisation, les gens poursuivront leur propre intérêt et surutiliseront la ressource, ce qui entraînera l’épuisement ou la dévastation des biens communs. Hardin applique la logique de Hobbes en affirmant que l’absence d’un organe directeur chargé de contrôler l’accès aux ressources communes entraîne ce qu’il appelle la« tragédie« , c’est-à-dire la surexploitation des ressources. Tout comme Hobbes pensait que la vie sans autorité souveraine serait« méchante, brutale et courte« , Hardin suggère que la vie sans régulation des ressources partagées conduit à un avenir tragique et insoutenable pour tout le monde.
Dans le contexte ghanéen, les ressources communes sont vitales pour l’économie et le bien-être de la population. Il s’agit notamment des forêts, des ressources en eau, des pâturages et des pêcheries, qui sont tous utilisés par les communautés locales pour assurer leur subsistance et leurs revenus. Traditionnellement, les communautés ghanéennes pratiquent une forme de partage des ressources basée sur les connaissances indigènes et les systèmes de gestion collective (Asante et al., 2017 ; Baaweh et al., 2022 ; Yahaya, 2012). Par exemple, dans les zones rurales, les forêts communautaires et les terres agricoles étaient souvent gérées par des chefs locaux ou des anciens qui appliquaient des règles sur le moment et la manière de récolter les ressources, garantissant ainsi la durabilité pour les générations futures (voir Adjei-Cudjoe, 2022). Cependant, l’augmentation rapide de la population, ainsi que le développement de l’économie et de la technologie, ont mis ces systèmes à rude épreuve (Obiero et al, 2023 ; Tom, Sumida Huaman, & McCarty, 2019). Les ressources telles que la terre, les forêts et l’eau sont de plus en plus considérées comme des biens publics librement accessibles à tous, ce qui entraîne une surexploitation. La théorie de Hardin entre en jeu dans le cas de la Galamsey (exploitation minière illégale) au Ghana, où des individus, motivés par la promesse de gains financiers rapides, s’engagent dans des pratiques destructrices pour l’environnement sans se soucier des impacts à long terme sur l’environnement ou la communauté dans son ensemble. Cette forme de comportement reflète le concept central de la tragédie de Hardin, où les actions individuelles, bien que rationnelles à court terme, entraînent un préjudice collectif à long terme.
Facteurs contribuant à la tragédie des biens communs au Ghana
Tout d’abord, la croissance démographique et l’augmentation de la demande sont l’un des principaux facteurs contribuant à la tragédie des biens communs au Ghana. C’était la principale préoccupation de Hardin et de Thomas Malthus lorsqu’il affirmait qu’un monde fini ne pouvait supporter qu’une population finie. Bien qu’ils aient été fortement critiqués, leur argument sur le problème de la population reste pertinent aujourd’hui, en particulier en Afrique et dans les pays du Sud, où la population urbaine devrait doubler d’ici 2050. Plus précisément, la population du Ghana augmente rapidement, ce qui exerce une pression croissante sur la terre, l’eau et d’autres ressources communes. La demande croissante de terres et d’accès à l’eau a entraîné une surexploitation de ces ressources, en particulier dans les zones rurales. En outre, l’augmentation du nombre de personnes migrant vers les centres urbains entraîne une demande accrue de ressources telles que le bois d’œuvre et le bois de chauffage, ce qui épuise encore davantage les ressources naturelles du pays.
Deuxièmement, dans la plupart des régions, l’absence de systèmes de gouvernance et d’application adéquats conduit à la tragédie des biens communs. L’incapacité du gouvernement à faire respecter les réglementations relatives à la déforestation, à la pêche ou à l’exploitation minière illégale donne aux gens la liberté d’abuser des ressources sans crainte d’être punis. C’est particulièrement vrai dans l’industrie minière où, malgré les tentatives du gouvernement pour y mettre fin, les activités de Galamsey se poursuivent sans relâche.
Troisièmement, la plupart des Ghanéens, en particulier ceux des zones rurales, dépendent des ressources naturelles pour vivre. Pour les petits agriculteurs, les pêcheurs et les mineurs, l’utilisation des ressources est souvent stimulée par le désir immédiat d’obtenir un revenu, ce qui, dans certains cas, les incite à exploiter les ressources de manière non durable. En outre, la propriété collective des ressources par un grand groupe de personnes peut parfois entraîner le dilemme du « resquilleur », où les membres surutilisent leur part sans jouer un rôle dans la conservation de la ressource.
Impacts contemporains de la tragédie des biens communs au Ghana
La déforestation, l’érosion des sols, la pollution de l’eau et la perte de biodiversité sont quelques-uns des effets les plus visibles de la tragédie des biens communs au Ghana. Par exemple, les activités de galamsey dans la région d’Ashanti et dans les régions de l’Est et de l’Ouest du Ghana ont conduit à une perte massive de la couverture forestière, ce qui a entraîné la perte d’habitats aquatiques et terrestres, affectant la distribution de la flore et de la faune et faussant finalement les structures écologiques des communautés locales (Ofori et al., 2024). Dans les milieux aquatiques d’eau douce, les rivières Pra, Ankobra, Oti, Offin et Birim ont toutes été contaminées, les transformant en diverses teintes de brun (Bedu-Addo, Okofo, Ntiamoah, & Mensah, 2024 ; Bessah et al., 2021 ; Kuffour et al., 2020 ; Boateng et al., 2014).
L’épuisement des ressources a provoqué une instabilité sociale et économique. Les économies locales souffrent de la diminution des prises des communautés de pêcheurs et de la baisse des rendements des agriculteurs due à la dégradation des sols. La pauvreté est exacerbée et les communautés rurales deviennent de plus en plus vulnérables. Les conflits liés à l’accès aux ressources, telles que la terre et l’eau, entraînent souvent des tensions entre les individus, les communautés et parfois même les agences gouvernementales.
La contamination de l’approvisionnement en eau et l’exposition à des produits chimiques nocifs, en particulier dans les villes minières, sont très dangereuses pour la santé. Le mercure, par exemple, un métal lourd utilisé pour combiner les particules d’or, est un problème très insidieux. Lorsqu’il est rejeté dans les masses d’eau, il se transforme en méthylmercure, une forme très toxique qui s’accumule dans les poissons et autres organismes aquatiques. L’ingestion par l’homme de poissons pollués peut entraîner un empoisonnement au mercure, qui se manifeste par des problèmes neurologiques et de développement chez les êtres humains, en particulier chez les enfants (Mensah & Tuokuu, 2023 ; Mensh & Darku, 2021).
Gérer les biens communs : Solutions et alternatives
Les solutions proposées par Hardin à la tragédie des biens communs, à savoir la privatisation et le contrôle de l’État, bien qu’efficaces dans certains contextes, peuvent ne pas convenir au Ghana. Cette observation s’applique tout particulièrement à l’examen du rôle central du gouvernement local et de la propriété communautaire dans la gestion des ressources (Adjei-Cudjoe, 2022). Les leçons tirées de l’expérience du Ghana en matière de politiques d’ajustement structurel (PAS) indiquent que les efforts de privatisation des ressources communes ont creusé les inégalités au lieu de s’attaquer aux problèmes sous-jacents (voir Terry, 2019). Par le biais des PAS, imposés aux pays en développement par des institutions financières internationales comme le FMI et la Banque mondiale, la privatisation a entraîné la perte du contrôle local sur les ressources qui étaient gérées par des systèmes communaux. L’évolution vers la privatisation a entraîné une augmentation des inégalités, les riches individus ou entreprises prenant le contrôle des ressources, tandis que les populations locales étaient exclues.
Ce processus a été particulièrement évident dans les domaines de la terre et de l’eau, où le contrôle et la propriété communautaires traditionnels ont été sapés, entraînant des cas d’accaparement de terres et d’exploitation des ressources locales (voir l’exemple de l’exploitation du sel d’Ada ; Adina et les communautés environnantes). Le contrôle de l’État, quant à lui, pose une série de problèmes différents. Bien qu’il puisse éviter la tragédie des biens communs par le biais de la réglementation, le succès de la gestion de l’État au Ghana a souvent été compromis par l’instabilité politique, le manque de capacités et la corruption (Asante, 2023 ; Asomah, 2019 ; Hackman et al., 2021). En outre, la centralisation du contrôle peut marginaliser les communautés locales, en négligeant leurs connaissances et pratiques étendues qui sont essentielles à une gestion efficace des ressources (Adeyanju et al., 2021).
Elinor Ostrom, lauréate du prix Nobel d’économie politique, a développé des idées importantes sur la manière dont les ressources communes sont gérées, qui contredisent directement les conclusions de la Tragédie des biens communs de Hardin. Alors que Hardin affirmait que les ressources communes souffriraient inévitablement de surexploitation en l’absence de privatisation ou d’un contrôle gouvernemental fort, Ostrom (1990) a présenté un point de vue plus optimiste et nuancé. Ses travaux soulignent que les communautés locales sont souvent capables de gérer efficacement les ressources partagées par le biais d’une action collective. Ostrom a critiqué les solutions simples et descendantes au problème de la gestion des biens communs, telles que la privatisation ou le contrôle de l’État, en faisant valoir qu’elles ne tiennent pas compte de la complexité des contextes locaux. Elle a souligné que si les cadres juridiques formels peuvent soutenir la gouvernance commune, les règles informelles, les normes et les pratiques locales sont souvent tout aussi importantes pour une gestion efficace. Ses conclusions ont montré que les gens sont en fait capables de développer eux-mêmes des systèmes de gestion durable, à condition qu’on leur donne les outils, le soutien et la liberté dont ils ont besoin.
Sur la base de ces observations, les solutions à la tragédie ghanéenne devraient plutôt viser à s’appuyer sur ces systèmes communaux. Des stratégies d’autonomisation centrées sur le local, impliquant les populations dans les processus de prise de décision et s’appuyant sur les systèmes de connaissance traditionnels peuvent produire des moyens plus équitables et durables de gestion des ressources. Les politiques doivent également s’attaquer aux causes profondes de l’inégalité de manière à ce que chaque groupe ait accès aux ressources sur un pied d’égalité et que les communautés locales conservent l’autorité sur les ressources dont elles dépendent.
Conclusion
La tragédie des biens communs reste un cadre pertinent pour décrire les défis actuels du Ghana en matière de gestion des ressources. L’utilisation inconsidérée de ressources telles que les forêts, l’eau et la pêche menace l’environnement et les moyens de subsistance de millions de personnes. Les travaux d’Elinor Ostrom ont profondément influencé la manière dont les universitaires, les décideurs politiques et les praticiens conçoivent la gestion des ressources communes. En soulignant la valeur des connaissances locales, de la participation, de la coopération et de la gouvernance adaptative, Ostrom a apporté une solution complète et contrastée à la prédiction pessimiste de Hardin sur la tragédie des biens communs. Ses recommandations sont encore très pertinentes aujourd’hui pour la gestion des ressources dans des pays comme le Ghana, où les communautés locales sont confrontées à des pressions croissantes sur les ressources communes, mais possèdent également des institutions d’action collective et des connaissances établies de longue date. En appliquant les règles d’Ostrom, le Ghana sera en mesure de surmonter la dichotomie dépassée de la privatisation et du contrôle de l’État, telle que prescrite par Hardin, et d’adopter des formes de gouvernance coopératives, décentralisées et adaptatives qui associent les traditions communautaires et les préoccupations environnementales modernes.
Référence
Adeyanju, S., O’Connor, A., Addoah, T., Bayala, E., Djoudi, H., Moombe, K., Reed, J., Ros-Tonen, M., Siangulube, F., Sikanwe, A., & Sunderland, T. (2021). Apprendre de la gestion communautaire des ressources naturelles (CBNRM) au Ghana et en Zambie : Leçons pour des approches intégrées du paysage. International Forestry Review, 23(3), 273-297. https://doi.org/10.1505/146554821833992776
Adjei-Cudjoe, B (2022). Potentiels, risques et enseignements tirés de la planification indigène de la décroissance au Ghana. Thèse de maîtrise, Université de Groningue.
Adom, R. K., Reid, M., Afuye, G. A. et Simatele, M. D. (2024). Évaluation des implications de la déforestation et du changement climatique sur les moyens de subsistance ruraux au Ghana : A Multidimensional Analysis and Solution-Based Approach. Environmental Management, 74(6), 1124-1144. https://doi.org/10.1007/s00267-024-02053-6
Agyare, A. K., Holbech, L. H. et Arcilla, N. (2024). Grandes attentes, performances moindres : Participant views of community-based natural resource management in Ghana, West Africa. Current Research in Environmental Sustainability, 7, 100251. https://doi.org/10.1016/j.crsust.2024.100251
Asante, E. A., Ababio, S. et Boadu, K. B. (2017). L’utilisation de pratiques culturelles indigènes par les Ashantis pour la conservation des forêts au Ghana. SAGE Open, 7(1). https://doi.org/10.1177/2158244016687611 (Travail original publié en 2017)
Asante, K. T. (2023). The politics of policy failure in Ghana : The case of oil palm. World Development Perspectives, 31, 100509. https://doi.org/10.1016/j.wdp.2023.100509
Asomah, J. Y. (2019). Quels sont les principaux moteurs de la corruption politique ghanéenne persistante ? Journal of Asian and African Studies, 54(5), 638-655. https://doi.org/10.1177/002190961982633
Baafi, J. A. (2024). Démêler l’hypothèse de la malédiction des ressources au Ghana : Analyzing Natural Resources and Economic Growth with a Focus on Oil Exploration. Economies, 12(4), 79. https://doi.org/10.3390/economies12040079
Baaweh, L., Baddianaah, I. et Baatuuwie, B. N. (2022). Connaissances et pratiques traditionnelles dans la conservation des ressources naturelles : A Study of the Zukpiri Community Resource Management Area, Ghana. International Journal of Rural Management, 19(2), 253-273.
https://doi.org/10.1177/09730052221087020 (Travail original publié en 2023)
Bedu-Addo, K., Okofo, L. B., Ntiamoah, A., & Mensah, H. (2024). Pollution des masses d’eau et impacts connexes sur les écosystèmes aquatiques et les services écosystémiques : Le cas du Ghana. Heliyon, 10(24). https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e40880
Bessah, E., Raji, A. O., Taiwo, O. J., Agodzo, S. K., Ololade, O. O., Strapasson, A. et Donkor, E. (2021). Variations basées sur le genre dans la perception de l’impact du changement climatique, de la vulnérabilité et des stratégies d’adaptation dans le bassin de la rivière Pra au Ghana. International Journal of Climate Change Strategies and Management, 13(4/5), 435-462. https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJCCSM-02-2020-
Boateng, D. O., Nana, F., Codjoe, Y. et Ofori, J. (2014). Impact de l’exploitation minière illégale à petite échelle
(Galamsey) sur la production de cacao dans le district d’Atiwa au Ghana. Int J Adv Agric Res, 2, 89-
99. https://www.academia.edu/download/77743706/Boateng_et_al.pdf
Frischmann, B. M., Marciano, A., & Ramello, G. B. (2019). Rétrospectives : Tragedy of the Commons after 50 Years. Journal of Economic Perspectives, 33(4), 211-228. https://doi.org/10.1257/jep.33.4.211
Hardin, G. (1968). La tragédie des biens communs. Science, 162, 1243-1248.
http://dx.doi.org/10.1126/science.162.3859.1243
Hackman, J. K., Ayarkwa, J., Osei-Asibey, D., Acheampong, A. et Nkrumah, P. A. (2021). Bureaucratic Factors Impeding the Delivery of Infrastructure at the Metropolitan Municipal and District Assemblies (MMDAs) in Ghana. World Journal of Engineering and Technology, 9(3), 482-502. https://doi.org/10.4236/wjet.2021.93032
Kuffour, R. A., Tiimub, B. B. M., Manu, I., & Owusu, W. (2020). L’effet de l’exploitation minière illégale
sur la végétation : Une étude de cas de la zone de Bontefufuo dans le district d’Amansie West
du Ghana. East African Scholars Journal of Agriculture and Life Sciences, 3(11).
https://doi.org/10.36349/easjals.2020.v03i11.002
Mensah, A. K. et Tuokuu, F. X. D. (2023). Polluer nos rivières à la recherche de l’or : Comment
durable sont des réformes visant à empêcher les mineurs informels de retourner sur les sites miniers dans les pays en développement.
Ghana ? Frontiers in Environmental Science, 11, 583. https://doi.org/10.3389/fenvs.2023.1154091
Mensah, E. O. et Darku, E. D. (2021). L’impact de l’exploitation minière illégale sur la santé publique : A case
study in kenyasi, the ahafo region in Ghana. Technium Soc. Sci. J., 23, 1.
https://techniumscience.com/index.php/socialsciences/article/view/4503
Navari, C. (1996). Hobbes, l’état de nature et les lois de la nature. In : Clark, I., Neumann, I.B. (eds) Classical Theories of International Relations. St Antony’s Series. Palgrave Macmillan, Londres. https://doi.org/10.1007/978-1-349-24779-0_2
Obiero, K. O., Klemet-N’Guessan, S., Migeni, A. Z., & Achieng, A. O. (2023). Bridging Indigenous and non-Indigenous knowledge systems and practices for sustainable management of aquatic resources from East to West Africa. Journal of Great Lakes Research, 49. https://doi.org/10.1016/j.jglr.2022.12.001
Ofori, S. A., Dwomoh, J., Yeboah, E. O., Martin, A. L., Nti, S., Philip, A., & Asante, C. (2024). An ecological study of galamsey activities in Ghana and their physiological toxicity. Asian Journal of Toxicology, Environmental, and Occupational Health, 2(1), 53-72. https://doi.org/10.61511/ajteoh.v2i1.2024.395
Ostrom, E. (1990). Governing the Commons : The Evolution of Institutions for Collective Action. Cambridge University Press.
Puplampu, D. A. et Boafo, Y. A. (2021). Exploring the impacts of urban expansion on green spaces availability and delivery of ecosystem services in the Accra metropolis. Environmental Challenges, 5, 100283. https://doi.org/10.1016/j.envc.2021.100283
Read, J. H. (1991). Thomas Hobbes : Power in the State of Nature, Power in Civil Society. Polity, 23(4), 505-525. https://doi.org/10.2307/3235060
Sadler, G B. (2010). The States of Nature in Hobbes’ Leviathan (2010). Government and History Faculty Working Papers. 9. https://digitalcommons.uncfsu.edu/govt_hist_wp/9
Takyi, S. A., Amponsah, O., Darko, G., Peprah, C., Apatewen Azerigyik, R., Mawuko, G. K., & Awolorinke Chiga, A. (2022). Urbanization against ecologically sensitive areas : effects of land use activities on surface water bodies in the Kumasi Metropolis. International Journal of Urban Sustainable Development, 14(1), 460-479. https://doi.org/10.1080/19463138.2022.2146121
Terry, S (2019) Politique d’ajustement structurel du Fonds monétaire international et conditionnalité des prêts au Ghana : impacts économiques, culturels et politiques. UVM Honors College Senior Theses. 319. https://scholarworks.uvm.edu/hcoltheses/319
Tom, M. N., Sumida Huaman, E. et McCarty, T. L. (2019). Les savoirs autochtones comme contributions vitales à la durabilité. International Review of Education, 65(1), 1-18. https://doi.org/10.1007/s11159-019-09770-9
Yahaya, A.-K. (2012). Indigenous knowledge in the management of a community-based forest reserve in the wa west district of ghanA Abdul-Kadiri Yahaya. Ghana Journal of Development Studies,, 9(1), 101-114. https://doi.org/10.20508/ijrer.v9i1