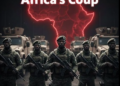I. Introduction et justification
Comme l’a dit Hardin en 1968, le désir insatiable de croissance dépasse les services de la terre qui ne pourraient être autorisés qu’à répondre aux besoins de l’humanité. Cependant, l’urbanisation rapide et la croissance des économies à travers le monde, et plus particulièrement en Afrique, exercent une pression sans précédent sur l’environnement. Des activités telles que le changement d’affectation des sols, la consommation d’énergie, les émissions dues aux transports et l’accumulation de déchets poussent les écosystèmes à leurs limites (Chen et al., 2022 ; Anwar et al., 2020). Les problèmes environnementaux devenant de plus en plus urgents aux niveaux local et mondial, la nécessité d’un développement durable et de politiques de gestion des ressources a pris de l’ampleur. Parmi les nouvelles approches qui ont suscité le plus d’intérêt figure la stratégie de décroissance, qui remet en question le fait que la croissance économique doive être considérée comme synonyme de développement social. Selon les partisans de la décroissance, l’humanité doit se tourner vers la limitation des ressources de notre planète pour éviter les conséquences négatives d’une croissance économique débridée (Lamker & Dieckhoff 2020). Cependant, une grande partie de la littérature sur la décroissance se situe dans le Nord global, ce qui présente une lacune dans la compréhension de la manière dont les principes de la décroissance s’appliquent au Sud global. Ce document cherche à combler cette lacune en étudiant le Ghana, en Afrique de l’Ouest, qui est récemment devenu une destination de croissance économique impressionnante, largement alimentée par les matières premières sous la forme de pétrole, d’or et de cacao. Cette croissance se fait cependant au détriment de graves impacts environnementaux, en particulier la dégradation des sols et la perte de biodiversité.
La décroissance représente donc l’un des cadres dans lesquels le développement peut être envisagé, avec d’éventuels freins à la croissance et la durabilité et l’équité nécessaires. Ce document examine comment les principes de la décroissance peuvent être adaptés au développement durable dans les pays du Sud à travers le contexte particulier du Ghana. S’appuyant sur une approche interdisciplinaire fondée sur les études environnementales, l’économie du développement et les sciences politiques, cette étude a cherché à faire la lumière sur la gestion durable des ressources au Ghana et dans des pays similaires.
2. conceptualiser la décroissance : Principes et pertinence dans le Sud global
La décroissance remet en question la croyance dominante selon laquelle la croissance économique continue est synonyme de progrès. Les racines critiques de la croissance du point de vue de son impact sur l’environnement ont conduit la décroissance à appeler à une réorientation vers la durabilité, l’équité et la justice sociale plutôt que vers une expansion économique continue (Langridge, 2024). Alors que le discours de la décroissance a souvent été considéré comme pertinent principalement dans le Nord, où les phénomènes de surconsommation et de surdéveloppement ont fait surface, il l’est de plus en plus pour le Sud, avec des pays comme le Ghana qui en font partie. La décroissance signifie que la poursuite d’une croissance continue du PIB est écologiquement irréalisable et non-égalitaire (Islar et al., 2024). La décroissance propose un modèle alternatif de production et de consommation qui met au centre le bien-être humain, la résilience écologique et la solidarité communautaire, plutôt que l’accumulation matérielle. Les stratégies associées à la décroissance comprennent l’agriculture durable, les énergies renouvelables, le localisme et la démocratie participative (Fitzpatrick et al., 2022 ; Khmara & Kronenberg, 2020). La décroissance est une perspective contre-hégémonique à l’impératif de croissance du capitalisme. Elle développe des valeurs concernant une société plus équitable socialement et plus équilibrée écologiquement, basée sur une qualité de vie approfondie sans consommation.
3. cadre conceptuel : Recadrer le discours sur la décroissance au Ghana
Pour appliquer efficacement les principes de la décroissance au Ghana, il est essentiel de tenir compte de la capacité institutionnelle, des valeurs culturelles et de la dynamique sociopolitique du pays. Le cadre intégré proposé dans cette étude repose sur trois piliers : l’aménagement inclusif du territoire, la reconnaissance des savoirs autochtones et la coopération internationale.
A. Pilier 1 : Aménagement inclusif du territoire
L’aménagement du territoire façonne un avenir urbain ou rural prospectif de la manière dont la croissance doit être réalisée pour qu’elle soit réellement durable, utile et bénéfique pour tous. Selon Hedidor, Bondinuba & Sadique (2016), un aménagement du territoire efficace équilibre considérablement les aspects sociaux, économiques et environnementaux des villes. Le cadre national de développement spatial du Ghana stipule qu’un développement bien planifié est la seule voie sûre vers la stabilité des investissements et l’amélioration du bien-être de toutes les communautés. Cependant, dans la pratique, le processus au Ghana est souvent descendant, avec des décisions contrôlées par les agences de planification urbaine, alors que l’implication des communautés locales est généralement nulle (Yeboah & Obeng-Odoom 2010). Il en résulte un développement chaotique et non planifié, avec des utilisations incompatibles des terres et des ressources, et des constructions dans des zones interdites ( Korah et al., 2017).
L’aménagement inclusif du territoire peut révolutionner la façon dont les communautés interagissent avec l’environnement et contribuer à une croissance plus durable pour le Ghana. La plupart des terres sont contrôlées par les chefs et les autorités coutumières ; par conséquent, l’approche conventionnelle et descendante de la planification laisse souvent de côté les besoins et les droits des communautés locales (Azumah & Noah 2023). L’intégration des connaissances locales et des approches participatives communautaires dans les processus de planification s’avère utile pour parvenir à une attribution équitable des terres, à une réduction des conflits et à un développement écologiquement viable. Cela se fera en permettant à la communauté de prendre part aux décisions, ce qui signifie que la planification sera plus en phase avec les besoins locaux. Cela contribuera donc à la stabilité sociale et augmentera la résilience de la population (Tanrıkul 2023 ; Damayanti & Syarifuddin 2020). En fin de compte, l’aménagement inclusif du territoire permet de s’assurer que le développement et la gestion des ressources ne sont pas seulement pour aujourd’hui, mais aussi pour l’avenir de tous les Ghanéens.
B. Pilier 2 : Reconnaissance des savoirs autochtones
Il est clair que les connaissances indigènes peuvent constituer un véritable trésor en matière de durabilité et que leur reconnaissance peut être déterminante pour le développement durable au Ghana. Les connaissances traditionnelles ont été transmises de génération en génération, donnant lieu à des solutions pratiques pour gérer l’environnement et ses ressources de manière à promouvoir l’équilibre à long terme. Diverses études menées au Ghana ont montré à quel point les systèmes de connaissances indigènes, par exemple l’agroforesterie, la conservation des sols et la gestion de l’eau, ont joué un rôle essentiel dans la protection des écosystèmes et de leur biodiversité (Asante, Ababio et Boadu, 2017 ; Awuah-Nyamekye, 2012 ; Hens, 2006). Les pratiques en matière de savoirs traditionnels ne sont pas seulement utiles, elles sont aussi au cœur d’une approche intégrée de la gestion des ressources. Cette approche intégrée est ce qui unit les éléments sociaux, économiques et environnementaux fondamentaux des moyens de subsistance dans la vie de la communauté.
Alors que la plupart des idéologies de développement du monde moderne accordent plus d’importance à la croissance économique qu’aux questions environnementales ou sociales, le savoir indigène défend l’harmonie avec la nature. L’accent mis sur les pratiques traditionnelles contribue à un objectif plus important : la durabilité écologique qui renforce l’identité culturelle et la cohésion de la communauté. L’autonomisation des communautés autochtones en tant qu’agents actifs de la planification du développement permet au Ghana de construire des systèmes plus résistants, plus inclusifs et plus durables qui reflètent les valeurs des personnes les plus directement concernées par leur mise en œuvre. La reconnaissance des savoirs autochtones ne vise pas à préserver l’héritage culturel, mais à utiliser ces savoirs dans la construction d’un avenir plus durable pour tous.
C. Pilier 3 : Collaboration mondiale
Si les connaissances et les stratégies locales sont importantes, la collaboration mondiale pour relever les défis de la durabilité est tout aussi pertinente pour le Ghana. Dans le monde de la durabilité qui évolue rapidement, le Ghana doit s’associer à des réseaux mondiaux qui permettent le partage des meilleures pratiques, des ressources et de l’expertise. Mais il est également très important que le Ghana alimente ces conversations mondiales à partir de ses propres termes. Pour ce faire, les dirigeants ghanéens doivent faire preuve d’autonomie intellectuelle et procéder à une évaluation critique des influences extérieures et de l’adéquation des partenariats internationaux avec les valeurs et les priorités de développement du pays (Onaah et al., 2018 ; Connell et al., 2017 ; Serequeberhan, 2013).
Ces partenariats mondiaux nécessiteront bien sûr de la diplomatie et l’art de la négociation. Le Ghana doit être en mesure de faire valoir ses intérêts tout en coopérant sur des défis mondiaux tels que le changement climatique et le développement durable. Ce faisant, le pays sera en mesure d’éviter les pièges de la dépendance et de s’assurer que toute influence extérieure est positive. La collaboration mondiale consiste essentiellement à partager les connaissances et les ressources, mais aussi à agir pour poursuivre la croissance d’une manière durable et adaptée au Ghana.
D. Intégration des piliers de la croissance durable et de la gestion des ressources
Pour que le Ghana parvienne à une décroissance durable, il est nécessaire de mettre en place un aménagement du territoire inclusif, de reconnaître les savoirs autochtones et de collaborer au niveau mondial (voir fig. 1). L’aménagement du territoire inclusif constitue la plate-forme fondamentale au sein de laquelle les connaissances autochtones et la perspective de la communauté doivent être prises en compte dans la prise de décision. Cela implique de véritables consultations avec les communautés locales et les autorités coutumières au Ghana, afin de s’assurer que les projets de développement sont conformes aux pratiques traditionnelles de gestion des terres, à la culture et à la cohésion sociale. Cette approche participative intègre également les connaissances indigènes dans les stratégies d’aménagement du territoire en vue d’une gestion durable des ressources et d’une bonne gestion de l’environnement. Dans le même temps, le Ghana tire parti de la collaboration internationale pour réaliser un aménagement du territoire inclusif grâce au partage de l’expertise, des ressources et du soutien. De même, tout en adoptant des connaissances et des expériences externes grâce à la collaboration internationale et à la mise en réseau, le Ghana affirme son autonomie et sa souveraineté pour s’assurer que les initiatives de développement restent adaptées au contexte et menées au niveau local.
Cette intégration favorise une approche holistique du développement durable, dans laquelle les communautés autochtones sont responsabilisées en tant que partenaires et gardiennes de leurs systèmes de connaissances. Cela permet de renforcer la cohésion sociale, de promouvoir la préservation de la culture et d’améliorer la résilience face aux défis environnementaux et socio-économiques. En fin de compte, la synergie entre l’aménagement inclusif du territoire, la reconnaissance du savoir indigène et la collaboration mondiale permet au Ghana de naviguer dans les complexités de la décroissance durable, en favorisant un équilibre harmonieux entre l’intégrité écologique, l’équité sociale et la prospérité économique.

Figure 1 : Approche intégrée de la croissance durable
Source : Analyste CISA (2024)
4. Conclusion
L’intégration de la planification spatiale inclusive, la reconnaissance des savoirs indigènes et la collaboration mondiale fournissent un cadre complet pour repenser la voie du Ghana vers la croissance durable et la gestion des ressources. En impliquant les communautés, en valorisant les savoirs traditionnels et en apprenant de la communauté internationale, le Ghana peut développer un avenir plus durable, plus équitable et plus résilient. Cette approche remet en question les modèles de croissance traditionnels et offre une nouvelle vision du développement, qui donne la priorité aux personnes, à la culture et à l’environnement plutôt qu’à une expansion économique incontrôlée. Pour aller de l’avant, il est essentiel que le Ghana continue à favoriser la collaboration à tous les niveaux, des communautés locales aux organisations internationales, afin de s’assurer que la décroissance durable devienne une réalité.
Référence
Anwar, A., Younis, M. et Ullah, I. (2020). Impact de l’urbanisation et de la croissance économique sur les émissions de CO2 : A Case of Far East Asian Countries. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(7), 2531. https://doi.org/10.3390/ijerph17072531
Asante, E. A., Ababio, S. et Boadu, K. B. (2017). L’utilisation de pratiques culturelles autochtones par les Ashantis pour la conservation des forêts au Ghana. Sage Open, 7(1). https://doi.org/10.1177/2158244016687611
Awuah-Nyamekye, S. (2012). Belief in Sasa : Its Implications for Flora and Fauna Conservation in Ghana. Nature and Culture, 7(1), 1-15. https://doi.org/10.3167/nc.2012.070101
Azumah, O. K. et Noah, S. (2023). Land Rights in Ghana. Open Journal of Social Sciences, 11(6), 20-32. https://doi.org/10.4236/jss.2023.116002
Chen, F., Liu, A., Lu, X., Zhe, R., Tong, J. et Akram, R. (2022). Évaluation des effets de l’urbanisation sur les émissions de carbone : The Transformative Role of Government Effectiveness. Frontiers in Energy Research, 10. https://doi.org/10.3389/fenrg.2022.848800
Connell, R., Collyer, F., Maia, J. et Morrell, R. (2017). Vers une sociologie mondiale de la connaissance : Réalités postcoloniales et pratiques intellectuelles. International sociology, 32(1), 21-37.
Damayanti, R. et Syarifuddin, S. (2020). The inclusiveness of community participation in village development planning in Indonesia (L’inclusivité de la participation communautaire dans la planification du développement des villages en Indonésie). Development in Practice, 30(5), 624-634. https://doi.org/10.1080/09614524.2020.1752151
Fitzpatrick, N., Parrique, T. et Cosme, I. (2022). Explorer les propositions de politiques de décroissance : A systematic mapping with thematic synthesis. Journal of Cleaner Production, 365, 132764. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.132764
Hardin, G. (1968). The Tragedy of the Commons (La tragédie des biens communs). Science, 162(3859), 1243-1248. https://doi.org/10.1126/science.162.3859.1243
Hedidor, D., Bondinuba, F. K. et Sadique, M. A. (2016). L’aménagement du territoire au Ghana : Antécédents et rôle des artisans locaux. Journal of Building Construction and Planning Research, 4(3), 201-218. https://doi.org/10.4236/jbcpr.2016.43013
Hens, L. (2006). Indigenous Knowledge and Biodiversity Conservation and Management in Ghana (Connaissances indigènes et conservation et gestion de la biodiversité au Ghana). Journal of Human Ecology, 20(1), 21-30. https://doi.org/10.1080/09709274.2006.11905897
Islar, M., Koch, M., Raphael, R. et Paulsson, A. (2024). La décroissance : Une voie vers des solutions transformatrices pour la durabilité socio-écologique. Global Sustainability, 7. https://doi.org/10.1017/sus.2024.13
Khmara, Y. et Kronenberg, J. (2020). La décroissance dans le contexte des transitions de la durabilité : A la recherche d’un terrain d’entente. Journal of Cleaner Production, 267, 122072. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.122072
Korah, P. I., Cobbinah, P. B., Nunbogu, A. M. et Gyogluu, S. (2016). Plans spatiaux et trajectoire de développement urbain à Kumasi, Ghana. GeoJournal, 82(6), 1113-1134. https://doi.org/10.1007/s10708-016-9731-1
Lamker, C. et Dieckhoff, V. S. (2022). Becoming a post-growth planner. Post-Growth Planning, 189-202. https://doi.org/10.4324/9781003160984-20
Langridge, N. (2024). Revenu de base inconditionnel et transition vers la décroissance : Adding empirical rigour to radical visions. Futures, 159, 103375. https://doi.org/10.1016/j.futures.2024.103375
Onah, O. O., Ezebuilo, D. H. C., & Ojiakor, D. C. T. (2018). Une approche afro-existentielle du développement de la société nigériane. International Journal of English Literature and Social Sciences, 3(5), 706-714. https://doi.org/10.22161/ijels.3.5.3
Sanga, F. (2021). La pertinence des connaissances indigènes dans la conservation des forêts naturelles face à la modernisation : Le cas du district de Makete, Southern Highlands of
Tanzanie. Ghana Journal of Geography, 13(2). https://doi.org/10.4314/gjg.v13i2.5
Serequeberhan, T. (2013). L’herméneutique de la philosophie africaine. Routledge.
Tanrıkul, A (2023). The Role of Community Participation and Social Inclusion in Successful Historic City Center Regeneration in the Mediterranean Region (Le rôle de la participation communautaire et de l’inclusion sociale dans la régénération réussie des centres-villes historiques dans la région méditerranéenne). Sustainability, MDPI, 15(9), 1-18. Yeboah, E. et Obeng-Odoom, F. (2010). Nous ne sommes pas les seuls à blâmer : Perspectives des assemblées de district sur l’état de la planification au Ghana. Commonwealth Journal of Local Governance, (7), 78-98. https://doi.org/10.5130/cjlg.v0i7.1893