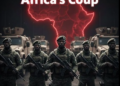L’Afrique court le risque de coups d’État incessants – et permanents – si les citoyens de ses pays font de la célébration des coups d’État la norme, a averti le professeur Abdoul Karim Sango, ancien ministre de la culture du Burkina Faso, dans une interview exclusive publiée par le Centre africain d’études stratégiques le 18 juin 2024.
Dans son discours, qui a abordé divers sujets tels que le rôle de la culture dans la lutte contre l’extrémisme violent, les valeurs africaines vis-à-vis de la démocratie et la relation entre la démocratie et la sécurité, le professeur Sango s’est fermement prononcé contre les coups d’État, quelle qu’en soit la raison bienveillante.
« Il ne faut pas être naïf : un régime civil peut être pire qu’un régime militaire s’il ne respecte pas les règles de la constitution. Mais il faut tout simplement empêcher l’armée d’intervenir dans la vie politique par des coups d’Etat, même si ses motivations peuvent sembler a priori sincères », a prévenu le professeur Sango : « C’est d’ailleurs pour cela que l’on constate un certain soutien populaire à certains coups d’Etat ».
« Prenons garde à ne pas en faire la règle, sinon nous risquons d’assister à des coups d’État permanents », a-t-il averti.
L’avertissement du professeur Sango fait écho à celui lancé par le président du Ghana, Nana Akufo-Addo, au début de l’année, le 27 février, lorsqu’il s’est adressé au parlement ghanéen. « Nous devons contribuer à endiguer cette évolution malvenue et à enraciner la démocratie en Afrique de l’Ouest. Le dirigeant ghanéen a rappelé que son pays avait eu sa « part d’instabilité politique et d’expérimentation sur la manière dont nous devrions nous gouverner », notant : « Il se peut que de nouveaux noms soient attribués à certaines des prétendues nouvelles idées avancées par certains aujourd’hui, mais j’ose dire qu’en y regardant de plus près, nous découvrirons qu’elles ne sont pas nouvelles : nous les avons essayées ici, et elles ont échoué ».
« Nous connaissons les messies tout-puissants et incontestables, les libérateurs, les rédempteurs et les divinités en uniforme militaire. Cela peut sembler nouveau pour certains, mais ceux d’entre nous qui sont là depuis un certain temps ont entendu l’argument passionné selon lequel la démocratie n’était pas une forme de gouvernement appropriée si nous voulions un développement rapide », a déclaré M. Akufo-Addo.
Pour le professeur Sango, ce dont l’Afrique a besoin, c’est de s’assurer que tout le monde accepte le régime constitutionnel. « Nous devons inclure des mécanismes dans la constitution afin que les dirigeants incompétents ou les impasses politiques puissent être résolus par la voie constitutionnelle », a-t-il proposé.
De même, le professeur Sango a fait remarquer qu' »il faut un mécanisme qui empêche les dirigeants de s’accrocher au pouvoir au-delà de leur mandat », en citant l’exemple de la procédure de destitution aux États-Unis : « Aux États-Unis, il existe une procédure de destitution. « Qu’est-ce qui empêche les Africains d’avoir une procédure de destitution dans leur constitution ? Pour lui, « si vous avez une crise sécuritaire qui se prolonge à cause de l’incompétence du président, il doit être possible de le destituer par des moyens constitutionnels sans que les militaires ne fassent un coup d’État. C’est à cela que nous devons travailler ».
Les récents coups d’État sont célébrés par les citoyens d’Afrique de l’Ouest
Certains coups d’État récents en Afrique de l’Ouest ont été accueillis avec joie par les citoyens de ces pays, reflétant une désillusion généralisée à l’égard de ce qu’ils percevaient comme des gouvernements civils démocratiquement élus corrompus, incompétents et égoïstes.
1. Mali (2020) : Le coup d’État qui a renversé le président Ibrahim Boubacar Keïta a été largement soutenu par la population. Les Maliens ordinaires ont exprimé leur frustration face à l’incapacité du gouvernement à gérer les difficultés économiques du pays et l’escalade de l’insurrection djihadiste. La promesse des militaires de s’attaquer à ces problèmes a été accueillie favorablement par 82 % de la population, selon Afrobarometer (Foreign Policy Research Institute) (ON POLICY Africa).
2. Guinée (2021) : En Guinée, le renversement du président Alpha Condé par le colonel Mamady Doumbouya a été approuvé par l’opinion publique. Le gouvernement de Condé était critiqué pour sa corruption et ses tentatives de prolonger son séjour au pouvoir au-delà des limites constitutionnelles. Les putschistes ont capitalisé sur le mécontentement de la population en promettant de lutter contre la pauvreté et la corruption (Foreign Policy Research Institute) (ON POLICY Africa).
3. Burkina Faso (2022) : Le coup d’État au Burkina Faso, mené par le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, a reçu le soutien enthousiaste de la jeunesse. Les citoyens ont exprimé leur désillusion face à l’incapacité du gouvernement à contenir la violence djihadiste et à améliorer les conditions de vie. La promesse de la junte d’améliorer la sécurité et la gouvernance a trouvé un écho auprès du public (America Magazine) (ON POLICY Africa).
Ces coups d’État mettent en évidence un schéma dans lequel les interventions militaires sont souvent perçues comme des solutions aux problèmes persistants de mauvaise gouvernance, de corruption et d’insécurité sous les gouvernements civils. Cependant, ce cycle souligne également la fragilité des institutions démocratiques dans la région, suggérant la nécessité de réformes plus profondes pour parvenir à une stabilité à long terme (Foreign Policy Research Institute) (America Magazine) (ON POLICY Africa).
Pour renforcer la démocratie sur le continent, le professeur Sango a déclaré que les libertés des personnes devaient être sauvegardées. « Je pense que la démocratie est l’espoir des peuples libres. Je pense que tous les peuples sont inspirés par la liberté et que personne ne veut être tenu en esclavage. De ce point de vue, je ne suis donc pas inquiet pour l’avenir de la démocratie », a-t-il déclaré au Centre d’études stratégiques de l’Afrique.
Il estime que les peuples d’Afrique doivent être autorisés à assimiler les idées et les idéaux de la démocratie selon leurs propres règles. « Nous devons donner aux Africains le temps d’avancer à leur propre rythme, en construisant une démocratie authentique, comme l’ont fait tous les pays qui donnent des leçons aujourd’hui. Les pays africains n’ont pas eu la chance de construire leur relation avec la démocratie au fil du temps. Nous ne nous sommes pas demandé quel modèle de parlement convenait aux Africains, par exemple. On ne s’est pas demandé quel serait le meilleur système politique : le président doit-il être élu au suffrage universel direct ou au suffrage universel indirect ? Nous ne nous sommes pas interrogés sur le modèle d’État qui convient le mieux aux États africains, qu’il s’agisse d’un État décentralisé, d’un État fédéral ou d’autre chose. Par exemple, je suis pour un Etat très décentralisé avec de vrais gouvernants légitimes au niveau local, plutôt que des fonctionnaires soumis à une administration centrale, comme c’est le cas dans le modèle burkinabé ».
Le professeur Sango souligne que ce dont l’Afrique a besoin aujourd’hui, c’est de mettre en œuvre des réformes courageuses pour renforcer les règles de la démocratie et les institutions, ce qui, à son tour, conduira à un renforcement de la sécurité. « Nous devons donc prendre de très bonnes décisions pour reconstruire l’État et ses institutions, mais seulement en ouvrant un débat inclusif et transparent », a-t-il proposé.
Par exemple, le professeur Sango a déclaré : « En principe, le soulèvement de 2014 aurait dû permettre au peuple burkinabè de régler définitivement les questions institutionnelles. Mais la courte période de transition ne l’a pas permis. Il faut écouter le peuple. Nous ne l’avons pas fait jusqu’à présent. Une partie de l’élite (dont je fais partie) a monopolisé le débat sur les choix stratégiques pour l’avenir du pays. Mais ce n’est pas cela la démocratie. La démocratie, c’est la voix du peuple, qui crée, à partir de nos traditions et de nos valeurs, des espaces de médiation et de délibération ».
Précisément, le professeur Sango estime que les partenaires de l’Afrique « doivent faire preuve d’une grande lucidité en cette période très difficile, et écouter attentivement, afin de ne pas manquer le combat, mais de continuer à construire ce rêve d’un monde de paix et de sécurité », ajoutant : « Les gouvernants ne doivent pas laisser le Burkina Faso basculer, ce qui aurait des conséquences pour toute la sous-région ouest-africaine » : « Les gouvernants ne doivent pas laisser le Burkina Faso basculer, ce qui aurait des conséquences pour toute la sous-région ouest-africaine. Ce que je dis ici concerne aussi nos pays frères, le Mali et le Niger. Il ne suffit pas de croire que l’on peut consolider la sécurité en Côte d’Ivoire ou au Ghana. Nous devons penser franchement à la sécurité collective de nos États. Cela passe par l’instauration de ce que de nombreux citoyens appellent la « vraie démocratie ».
Cependant, tout comme Nelson Mandela, Wole Soyinka, Achille Mbembe, Cheick Anta Diop, Felwine Sarr et Joseph Ki-Zerbo, le professeur Sango estime que la démocratie n’est pas étrangère à l’Afrique. Il affirme qu’elle est profondément ancrée dans les valeurs africaines. Lorsque je dis que la démocratie est profondément ancrée dans les valeurs africaines, c’est principalement en réaction à ceux qui prétendent que la démocratie est une valeur imposée aux Africains par les Occidentaux et que le soi-disant « échec de la démocratie » est lié au fait qu’elle ne fait pas partie de notre culture », a-t-il expliqué au Centre d’études stratégiques de l’Afrique.
La démocratie, a noté le professeur Sango, est une manière d’organiser les sociétés avec « l’idée que la population a droit à la liberté » et que « les gens doivent être traités de manière égale et bénéficier des mêmes droits et libertés civiles ». Deuxièmement, il a indiqué que la démocratie implique « l’idée que l’autorité des dirigeants pour organiser la société ne doit pas être absolue ».
« Dans un sens, la démocratie peut se résumer à la limitation du pouvoir par ceux qui le détiennent, ainsi qu’au respect de la liberté et de l’action des citoyens. C’est autour de ces principes que chaque société définit son modèle de démocratie et aucune société démocratique ne devrait s’écarter de ces principes. À partir de ces éléments, la question est de savoir si, dans les sociétés africaines d’avant l’ère coloniale, il existait des sociétés où le pouvoir des dirigeants était limité. La réponse est un « oui » catégorique », a-t-il poursuivi : « Et le pouvoir était limité par ce que nous appelons la coutume. Nos coutumes sont issues des lois des sociétés traditionnelles précoloniales. L’usage de l’écriture étant limité, ces lois étaient largement transmises par le biais de récits et de traditions au sein de la communauté ».
Il a illustré son propos : « Certaines sociétés africaines, selon d’éminents anthropologues, étaient fondées sur l’idée qu’il ne devait pas y avoir de chef au-dessus des autres, optant plutôt pour une forme où tous les citoyens étaient traités sur un pied d’égalité. De telles sociétés ont existé en Afrique. Considérant que la démocratie est un système dans lequel les gouvernants n’exercent pas un pouvoir absolu, je peux citer les exemples africains des sociétés Moagha, Lobi et Gurunsi. La démocratie n’est pas quelque chose de nouveau ou d’inconnu en Afrique avant la colonisation ».
Un autre exemple, souligne le professeur Sango, « est la forme de prise de décision dans les sociétés africaines traditionnelles, basée sur le consensus, communément appelée l’arbre à palabres. D’un point de vue démocratique, je ne vois pas de meilleure façon de prendre des décisions. Les sociétés africaines sont fondées sur le principe que les idéaux du groupe doivent être préservés dans toutes les situations. Ainsi, en Afrique, lorsqu’il y a un problème, on en discute – hommes, femmes et jeunes. On s’écoute les uns les autres. Certains auteurs vont jusqu’à dire que les Africains n’ont pas la notion du temps. C’est vrai, les Africains ne sont pas esclaves du temps. C’est plutôt le temps qui doit se soumettre aux Africains parce que ce qui est important, c’est la cohésion de la société. C’est la communauté qui compte ».
Il est « évident », selon le professeur Sango, « que certaines formes de gouvernement héritées de la colonisation ont contribué à briser ces modèles sociaux inhérents. Mais nous devons reconnaître que nous avons contribué à briser nos systèmes internes d’organisation sans évaluer si c’était ce qu’il y avait de mieux pour la population. Dès lors, lorsque nous avons hérité d’un modèle extérieur sans l’adapter à nos valeurs et à notre identité, cela n’a pas manqué de créer des problèmes. Aujourd’hui, le résultat est que la façon dont la « démocratie » est pratiquée dans certains pays est très contestée. Et pour cause !