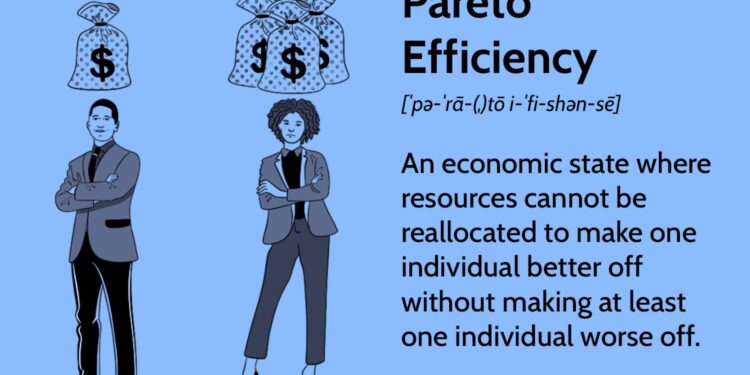Introduction
En Afrique de l’Ouest, l’insécurité s’aggrave rapidement. De la progression incessante des groupes extrémistes dans le Sahel à la vague croissante de violence menée par les jeunes dans les grandes zones urbaines, la région est soumise à de fortes pressions. Les gouvernements, aux prises avec des budgets limités et des pressions sociales croissantes, doivent faire des choix difficiles quant à la répartition de ressources limitées. Ils s’appuient souvent sur des principes économiques conventionnels, tels que l’optimalité de Pareto, pour éclairer ces décisions. Ce principe, souvent loué pour son efficacité, postule que la redistribution des ressources n’est justifiable que si aucun individu n’en subit les conséquences négatives. S’il peut offrir des perspectives intéressantes dans des économies stables et bien gouvernées, sa pertinence dans des nations fragiles et inégales comme celles de l’Afrique de l’Ouest soulève une question cruciale et troublante : efficace pour qui ?
Comprendre l’optimalité de Pareto et ses hypothèses
L’optimalité de Pareto, principe issu des travaux de l’économiste italien Vilfredo Pareto, décrit un état dans lequel il est impossible d’améliorer la situation d’une personne sans avoir un impact négatif sur une autre (Varian, 2014). Dans le domaine de la théorie économique, il est depuis longtemps reconnu comme une norme pour une distribution efficace des ressources. Dans des conditions de marché idéales, où chaque participant a le même accès à l’information et le même pouvoir d’influence, l’efficacité de Pareto garantit que les ressources sont utilisées de manière à éviter le gaspillage.
Néanmoins, ce cadre ne reconnaît pas les inégalités significatives qui influencent la gouvernance dans les pays d’Afrique de l’Ouest. Il ne tient pas compte de la propriété des ressources, des moyens par lesquels elles ont été obtenues et de la question de savoir si leur allocation favorise des objectifs sociétaux plus larges. Dans les sociétés marquées par de profondes inégalités, la recherche de l’efficacité de Pareto peut, par inadvertance, renforcer la position d’une minorité privilégiée au lieu d’améliorer le bien-être de l’ensemble de la population. Par conséquent, les politiques jugées « efficaces » dans ce cadre peuvent exacerber la pauvreté, accroître l’exclusion et, en fin de compte, provoquer davantage d’insécurité.
La sécurité comme bien public et victime d’une mauvaise allocation structurelle en Afrique de l’Ouest
La sécurité s’apparente à l’éducation ou à l’accès à l’eau potable. Elle est considérée comme un bien public qui devrait être universellement accessible et ne pas être réduit par l’usage. Cependant, dans de nombreux pays d’Afrique de l’Ouest, la distribution de la sécurité est inégale. Au lieu de servir l’ensemble de la population, elle est souvent concentrée dans les zones urbaines et adaptée aux intérêts de l’élite, laissant les communautés rurales et marginalisées exposées. Le Nigeria illustre bien cette disparité. Même avec un budget de défense qui a grimpé à 2,98 billions d’euros en 2023 (Budget Office of the Federation, 2023), le pays continue de faire face à une insécurité généralisée, y compris des insurrections, des enlèvements et des conflits communautaires violents.
Cette disparité est enracinée dans un problème structurel plus profond. Adeleye (2016) fait référence à un phénomène connu sous le nom d’incapacité économique de Pareto, qui se produit lorsque l’économie d’un pays repose fortement sur un ou deux secteurs dominants qui contribuent de manière significative au PIB mais offrent des possibilités d’emploi limitées. Au Nigéria, l’industrie pétrolière représente ce scénario. Elle génère des revenus substantiels mais n’emploie qu’un faible pourcentage de la main-d’œuvre. Il en résulte ce qu’Adeleye appelle un écart de Pareto, c’est-à-dire que l’impact économique d’une industrie ne correspond pas aux avantages qu’en retire la population en général. Il en résulte un scénario où la richesse coexiste avec la pauvreté, la croissance économique masquant l’accroissement des inégalités et de l’exclusion.
Cette exclusion peut avoir de graves répercussions. De nombreux jeunes, incapables de trouver un emploi ou de s’engager de manière significative dans la société, deviennent vulnérables au recrutement par des groupes extrémistes ou des organisations criminelles. Bien que les dépenses de défense soient considérées comme cruciales pour la sécurité nationale, elles négligent souvent les causes profondes de l’insécurité, telles que le chômage, une éducation inadéquate et des institutions locales affaiblies. Du point de vue de l’efficacité de Pareto, la réaffectation des fonds aux secteurs sociaux pourrait perturber ceux qui ont des intérêts directs, en particulier les élites qui bénéficient des dépenses militaires. Néanmoins, du point de vue du bien-être public, une telle réaffectation est à la fois logique et impérative. Si rien n’est fait, le cycle de fragilité et d’instabilité risque de perdurer.
Au-delà de la pensée Pareto : Modéliser de meilleurs choix
Le débat sur l’allocation optimale des ressources s’étend au-delà de la seule sécurité nationale. Selon Stuart et al. (2019), un conflit similaire s’est manifesté dans le domaine de la santé publique. Leur étude sur le financement de la lutte contre le VIH au Togo et au Soudan a révélé que les tentatives de réaffectation des ressources au profit d’une population plus large étaient rejetées comme inefficaces. Cela était dû à la perception que même des inconvénients mineurs pour un groupe particulier étaient intolérables, ce qui met en évidence une faiblesse importante de la pensée rigide de Pareto. Elle tend à maintenir la répartition actuelle des ressources, même lorsqu’elle ne sert pas l’intérêt général.
Une stratégie plus adaptable est présentée par Ojamaa et Tyugu (2008), qui ont utilisé un modèle d’optimisation de Pareto pour relever les défis de la planification de la sécurité. Leur cadre a permis aux décideurs politiques de comprendre les compromis entre le coût et l’efficacité en utilisant des techniques de programmation dynamique. Bien qu’ils se soient concentrés sur des domaines tels que la banque et les systèmes d’information, la pertinence de leurs conclusions pour la sécurité nationale est évidente. Avec des ressources limitées, l’objectif devrait être de maximiser les résultats pour la majorité plutôt que de préserver les avantages de quelques privilégiés.
Recadrer la frontière : Vers une efficacité inclusive
Les faits montrent qu’il est urgent de reconsidérer ce que nous entendons par efficacité dans des contextes fragiles et inégaux. En Afrique de l’Ouest, cela implique l’adoption d’une frontière de Pareto incluant la sécurité – un cadre dans lequel la distribution des ressources prend en compte non seulement l’efficacité technique mais aussi l’équité, la sécurité humaine et la résilience durable. Cette redéfinition exige une transformation de notre planification, de notre allocation et de nos actions, ce qui nécessiterait les approches suivantes :
- Comprendre que la sécurité a de multiples facettes et qu’elle repose sur l’expérience: La sécurité ne se limite pas à une présence militaire, à des barrières ou à des clôtures ; elle englobe la capacité de rentrer chez soi sans crainte, de trouver un emploi décent et de savoir que votre communauté vous soutiendra dans les moments difficiles. Une société véritablement sûre investit dans l’éducation, les possibilités d’emploi et la confiance, plutôt que dans les seuls mécanismes de défense.
- Centrer l’équité dans la planification: Historiquement, certaines communautés ont toujours été négligées alors que d’autres ont bénéficié d’une attention excessive. La planification devrait corriger ces disparités en donnant la priorité aux régions où les individus se sentent ignorés ou marginalisés. L’équité consiste à s’assurer que chacun dispose de ce dont il a besoin pour se sentir en sécurité, soutenu et reconnu.
- Mettre en œuvre des stratégies adaptatives qui reflètent la réalité: Dans des environnements complexes et en évolution rapide, les politiques rigides et uniformes ne suffisent pas. Les gouvernements doivent utiliser des outils de planification adaptables qui leur permettent d’évaluer les compromis, de simuler différents avenirs et d’évaluer les effets réels, plutôt que de se contenter de surveiller les dépenses financières. Une gouvernance efficace consiste à apprendre et à s’adapter, plutôt que de se contenter de gérer des intrants.
- Collaborer au-delà des frontières: L’insécurité ne s’arrête pas aux frontières nationales. Les organisations régionales comme la CEDEAO doivent être habilitées à échanger des renseignements, à coordonner des actions et à mettre en commun des ressources. Les menaces transfrontalières nécessitent une collaboration transfrontalière.
- Réexaminer le concept d’efficacité: Dans les pays fragiles, l’efficacité ne doit pas se limiter à la rapidité ou à la rentabilité. Elle doit permettre de déterminer si les politiques entraînent une transformation réelle et durable. Une politique efficace n’apparaît peut-être pas clairement dans les rapports financiers, mais elle devrait permettre aux individus de se sentir plus en sécurité, d’être mieux intégrés et d’avoir plus d’espoir dans leur vie quotidienne. L’objectif n’est pas d’abandonner l’efficacité de Pareto, mais de la situer dans un cadre plus large de valeurs et de réalités qui résonnent avec les expériences vécues par les citoyens dans des environnements fragiles.
Conclusion
Dans une région aussi complexe et instable que l’Afrique de l’Ouest, la question de l’efficacité des ressources est loin d’être théorique ; elle est profondément politique. Lorsque des politiques sont qualifiées d' »efficaces » mais que des millions de personnes se retrouvent dans l’insécurité, au chômage et sans voix, nous devons nous poser la question suivante : efficace pour qui ?
L’efficacité réelle dans les environnements fragiles nécessite plus que des rapports financiers. Elle exige du courage politique, une gouvernance inclusive et une volonté de confronter les principes économiques qui ignorent l’inégalité. Alors que l’insécurité continue de saper les réalisations en matière de développement, l’Afrique de l’Ouest doit transcender les définitions restreintes de l’optimalité et adopter un modèle dans lequel l’efficacité et la justice ne sont pas des objectifs opposés, mais des priorités profondément liées.
Références
- Adeleye, E. O. (2016). The Pareto Theory of Poverty-induced Corruption (La théorie de Pareto de la corruption induite par la pauvreté). Journal of Poverty, Investment and Development, 25, 73-77.
- Bureau du budget de la Fédération (2023). Budget approuvé 2023. https://www.budgetoffice.gov.ng
- Ojamaa, A. et Tyugu, E. (2008). Pareto-Optimal Situation Analysis for Selection of Security Measures (Analyse de la situation optimale pour la sélection des mesures de sécurité). Actes de MILCOM 2008, IEEE.
- Stuart, R. M., Haghparast-Bidgoli, H., Panovska-Griffiths, J., et al. (2019). Application du critère « no-one worse off » pour concevoir des réponses au VIH efficaces au sens de Pareto au Soudan et au Togo. AIDS Journal, Publish Ahead of Print. doi:10.1097/QAD.0000000000002155
- Varian, H. R. (2014). Intermediate Microeconomics : A Modern Approach (9e éd.). W.W. Norton.