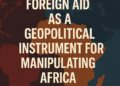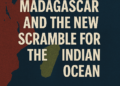Introduction
À l’aube du XXIe siècle, les priorités mondiales ont été réorganisées de façon spectaculaire, l’Afrique sortant de l’ombre de son passé post-colonial pour devenir une arène dynamique de la concurrence internationale. L’époque où l’Europe contrôlait totalement le destin économique et politique du continent est révolue. Une « nouvelle course à l’Afrique » est en cours, qui se distingue de celle qui l’a précédée au XIXe siècle par son impératif économique plutôt que territorial et, surtout, par la diversité de ses acteurs. Des puissances émergentes telles que la Chine, la Russie, la Turquie, le Brésil et les États du Golfe ont rejoint des acteurs traditionnels tels que l’Union européenne (UE) et les États-Unis, modifiant fondamentalement le paysage géopolitique. Cet article soutient que cette concurrence multipolaire a involontairement, mais significativement, doté les États africains d’un pouvoir de négociation accru, leur permettant de poursuivre leurs intérêts nationaux et continentaux avec un plus grand effet de levier face à leurs partenaires européens traditionnels. Cette évolution, illustrée par les développements au Ghana et sur l’ensemble du continent, marque un tournant dans la redéfinition des relations entre l’Europe et l’Afrique.
Le contexte historique : Du colonialisme au partenariat asymétrique
Pendant des siècles, les relations entre l’Europe et l’Afrique ont été marquées par l’exploitation, d’abord par la traite transatlantique des esclaves, puis par le colonialisme. L’indépendance formelle des nations africaines au milieu du XXe siècle ne s’est pas immédiatement traduite par une autonomie économique ou politique. L’ère postcoloniale a été largement caractérisée par un partenariat asymétrique, souvent appelé « néocolonialisme », dans lequel les nations européennes ont conservé une influence économique significative par le biais de l’aide, des conditions commerciales et des institutions financières (Cheru & Obi, 2010). Les économies africaines sont restées largement structurées pour répondre aux besoins européens, principalement en tant que fournisseurs de matières premières et marchés pour les produits finis. Les pays européens sont restés la principale source d’investissements directs étrangers (IDE), d’aide au développement et de partenariats en matière de sécurité, laissant aux États africains des options limitées et donc un faible pouvoir de négociation (Whitfield, 2011).
Le Ghana, par exemple, pays phare de l’indépendance, a hérité d’une économie fortement dépendante des exportations de cacao vers les marchés européens. Ses efforts d’industrialisation après l’indépendance se sont souvent heurtés aux conditionnalités des institutions financières occidentales, ce qui a limité sa marge de manœuvre. L’architecture de sécurité de nombreuses nations africaines, dont le Ghana, a également conservé des liens étroits avec les anciennes puissances coloniales, ce qui a souvent entraîné une dépendance à l’égard de la formation et de l’équipement militaires européens. Cette dépendance signifiait que les États africains devaient souvent accepter les conditions dictées par leurs partenaires européens, même si elles n’étaient pas entièrement alignées sur leurs aspirations nationales en matière de développement.
La montée des puissances émergentes : Un changement de donne
Le 21e siècle a vu la montée en puissance spectaculaire de nouveaux acteurs mondiaux, dont l’engagement en Afrique a fondamentalement perturbé l’ordre établi. La Chine, en particulier, s’est imposée comme le « nouvel » acteur le plus important, avec son initiative « la Ceinture et la Route » (BRI) et ses investissements considérables sur tout le continent. La Russie s’est réengagée dans la diplomatie de la sécurité et des ressources, tandis que la Turquie, le Brésil et les États du Golfe étendent leurs empreintes économiques et culturelles.
L’engagement global de la Chine : L’approche de la Chine à l’égard de l’Afrique se caractérise par le financement d’infrastructures à grande échelle, l’acquisition de ressources et l’essor du commerce, souvent avec moins de conditionnalités politiques que les donateurs occidentaux traditionnels (Brautigam, 2009). Des projets tels que les réseaux ferroviaires, les ports et les centrales électriques construits par des entreprises chinoises ont eu un effet transformateur dans toute l’Afrique. Au Ghana, les entreprises chinoises ont joué un rôle déterminant dans divers projets d’infrastructure, notamment le projet de centrale hydroélectrique de Bui et la construction de routes et de ports, en offrant une exécution rapide et des exigences de gouvernance souvent moins strictes que celles de leurs homologues européens. Cela permet au Ghana, par exemple, de comparer les offres de prêt chinoises à celles de la Banque mondiale ou des banques de développement européennes, créant ainsi un marché concurrentiel pour le financement du développement.
La diplomatie russe en matière de sécurité et de ressources : La Russie est redevenue un acteur important de la sécurité, en particulier dans la région du Sahel, en offrant une assistance militaire et une formation, souvent en échange d’un accès aux ressources minérales ou d’une influence politique. Elle constitue ainsi un partenaire de sécurité alternatif pour les États africains confrontés à des insurrections, comme au Mali et au Burkina Faso, où le retrait des forces françaises a créé un vide. Bien qu’elle ne soit pas aussi importante au Ghana, la disponibilité générale de divers partenaires en matière de sécurité signifie que l’assistance militaire européenne n’est plus la seule option.
L’ouverture économique et culturelle de la Turquie : La Turquie a rapidement développé ses missions diplomatiques, ses échanges commerciaux et ses liens culturels en Afrique, en mettant l’accent sur les relations interentreprises et l’aide humanitaire (Özcan & Akgün, 2012). Turkish Airlines a également amélioré de manière significative la connectivité aérienne sur le continent. Cet engagement diversifié offre aux nations africaines de nouvelles routes commerciales et de nouveaux partenaires d’investissement au-delà des réseaux européens traditionnels.
Le Brésil et les investissements des États du Golfe : Le Brésil, tirant parti de son expérience commune en tant que pays en développement, s’est concentré sur le transfert de technologies agricoles et la coopération Sud-Sud. Les États du Golfe, comme les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite, investissent de plus en plus dans divers secteurs, de la logistique et des ports à l’agriculture, sous l’impulsion de leurs fonds souverains.
Cet afflux d’acteurs diversifiés signifie que les États africains disposent désormais de véritables options. Alors que l’aide ou les investissements européens n’étaient pas négociables, les dirigeants africains peuvent désormais comparer les offres, faire pression sur un partenaire et obtenir des conditions plus favorables à leurs intérêts nationaux. Ce passage d’une dépendance unipolaire à un engagement multipolaire est la pierre angulaire du pouvoir de négociation accru de l’Afrique.
L’effet de levier retrouvé de l’Afrique : Exemples du continent et du Ghana
Ce nouveau paysage géopolitique s’est directement traduit par un pouvoir de négociation accru pour les États africains dans leurs relations avec l’Europe, et ce dans différents secteurs.
1. Renégocier les contrats de ressources et la souveraineté économique
Les pays africains affirment de plus en plus leur contrôle sur leurs ressources naturelles.
Le secteur minier ghanéen : Le Ghana, un important producteur d’or, a toujours été confronté à des difficultés pour maximiser les rendements de ses richesses minières en raison d’accords qui favorisent souvent les sociétés minières étrangères. De nouveaux acteurs ayant manifesté leur intérêt, le Ghana peut renégocier les conditions. Le gouvernement du président Nana Akufo-Addo s’est efforcé d’augmenter le contenu local dans l’exploitation minière et d’extraire davantage de valeur de son or, en tirant parti de l’intérêt concurrentiel des investisseurs non européens (Ayisi, 2019). Le Ghana a également créé le Ghana Gold board (GoldBod) sous la présidence de John Dramani Mahama pour agir en tant qu’autorité unique pour l’achat, la vente et l’exportation d’or et d’autres minéraux précieux, ce qui permet de formaliser le secteur, de réduire la contrebande et de stimuler les bénéfices nationaux. Si les entreprises européennes restent importantes, la présence d’entreprises chinoises, australiennes et canadiennes (pas exclusivement européennes) signifie que le Ghana dispose d’alternatives si les conditions ne sont pas favorables.
Contrats pétroliers et gaziers : Dans les pays émergents producteurs de pétrole et de gaz en Afrique (par exemple, le Sénégal, le Mozambique, l’Ouganda), les gouvernements examinent minutieusement les contrats signés précédemment avec les majors occidentales, cherchant à obtenir des taux de redevance plus élevés, une plus grande participation de l’État et de meilleures dispositions en matière de contenu local. Cette évolution s’explique en partie par le fait que les géants de l’énergie non européens sont désireux d’investir.
2. Diversifier le financement du développement et réduire les conditionnalités
Les États africains ne dépendent plus uniquement de l’aide conditionnelle et des prêts accordés par les institutions européennes et occidentales.
Financement des infrastructures : Les pays africains, dont le Ghana, se sont souvent tournés vers le financement chinois pour de grands projets d’infrastructure lorsque les institutions occidentales n’étaient pas disposées ou trop lentes à fournir un financement, ou lorsque leurs conditions étaient jugées trop onéreuses (Kragelund, 2008). Cette situation a fait pression sur les banques de développement européennes pour qu’elles proposent des montages financiers plus compétitifs et plus souples. L’engagement du Ghana auprès de la « Banque de développement de Chine » pour des prêts d’infrastructure substantiels illustre cette diversification, obligeant les autres partenaires à reconsidérer leurs conditions.
3. Affirmer l’autonomie en matière de sécurité et gérer les crises régionales
L’évolution du paysage sécuritaire en Afrique est un autre domaine dans lequel le pouvoir de négociation du continent s’est accru.
Des partenariats de sécurité en mutation : Le retrait des forces françaises du Mali et du Burkina Faso, en partie dû à des exigences politiques locales et au ressentiment de la population, met en évidence le désir croissant des États africains de diversifier leurs partenariats en matière de sécurité (Lynch, 2023). Les pays se tournent désormais vers la Russie pour obtenir des formations et des équipements militaires, ou intensifier leur coopération avec d’autres États africains. Les pays européens sont ainsi poussés à réformer leurs programmes d’aide à la sécurité pour qu’ils soient davantage alignés sur les priorités africaines et moins perçus comme des interventions néocoloniales.
Le maintien de la paix sous l’égide de l’Afrique : L’Union africaine (UA) a de plus en plus affirmé son rôle dans la gestion de la sécurité continentale, en promouvant des « solutions africaines aux problèmes africains ». Si le soutien financier et logistique de l’Europe reste crucial, le mandat politique d’intervention de plus en plus large de l’UA (par exemple, dans la crise post-électorale gambienne) lui permet de mieux se faire entendre dans les dialogues sur la sécurité avec l’Europe.
4. Exiger des politiques migratoires plus équitables
La migration reste une question controversée entre l’Europe et l’Afrique, mais les États africains gagnent progressivement en influence.
Coopération en matière de retour : Les nations européennes souhaitent vivement que les États africains coopèrent au retour des migrants en situation irrégulière. Les gouvernements africains peuvent s’en servir comme monnaie d’échange pour exiger de meilleurs régimes de visas, des voies d’immigration légales plus nombreuses et des investissements plus importants dans la création d’emplois en Afrique afin de s’attaquer aux causes profondes de la migration (Castles, 2010).
Défis et nuances : Une perspective équilibrée
Si le pouvoir de négociation de l’Afrique s’est incontestablement accru, il est essentiel de reconnaître qu’il s’agit d’une évolution complexe et nuancée qui comporte son propre lot de défis.
Durabilité de la dette : La facilité d’accès aux prêts de certaines puissances émergentes, en particulier la Chine, a suscité des inquiétudes quant à la viabilité de la dette dans plusieurs pays africains. Le Ghana, par exemple, a été confronté à des difficultés dans la gestion de sa dette publique, et des questions ont été soulevées quant aux implications à long terme de certains prêts non traditionnels (Moss & Subramanian, 2021).
Des conditionnalités déguisées : Si certaines puissances émergentes peuvent proposer des prêts « sans conditions », leur influence peut s’accompagner d’autres conditions moins explicites, telles qu’un soutien diplomatique dans les forums internationaux ou un accès exclusif aux marchés.
Gouvernance et transparence : Le manque de transparence de certains accords conclus avec des partenaires non traditionnels peut exacerber les problèmes de gouvernance et de corruption dans les États africains, ce qui risque de saper les institutions démocratiques (Transparency International, 2022).
Approche fragmentée : Alors que l’UA vise à parler d’une seule voix, les différents États africains concluent souvent des accords bilatéraux fondés sur leurs intérêts nationaux immédiats, ce qui peut parfois affaiblir le pouvoir de négociation collectif du continent.
Malgré ces défis, le changement fondamental demeure. Les États africains disposent désormais d’un plus grand nombre d’options et, par conséquent, d’une plus grande marge de manœuvre dans l’élaboration de leurs relations extérieures. Le continent n’est plus un destinataire passif des politiques extérieures, mais un participant actif dans un monde multipolaire.
Conclusion
Le 21e siècle a sans équivoque ouvert une nouvelle ère pour les relations entre l’Europe et l’Afrique. La « nouvelle course à l’Afrique », motivée par l’engagement de diverses puissances émergentes, a fondamentalement modifié la position géopolitique du continent. Les États africains, dont le Ghana, peuvent désormais tirer parti de cette concurrence pour obtenir de leurs partenaires européens traditionnels des conditions plus favorables en matière d’investissement, de commerce et de coopération dans le domaine de la sécurité. Cela leur a permis d’acquérir une plus grande autonomie économique, de diversifier le financement de leur développement et de mieux se faire entendre dans les affaires mondiales.
Si la relation avec l’Europe reste vitale, elle évolue d’une dynamique asymétrique et dépendante de l’aide à une dynamique où les nations africaines affirment de plus en plus leurs intérêts en tant que partenaires stratégiques. Les défis liés à la gestion de partenaires multiples, à la garantie de la viabilité de la dette et à la promotion de la bonne gouvernance demeurent. Toutefois, la tendance générale va dans le sens d’un engagement plus équitable et mutuellement bénéfique, où l’action croissante de l’Afrique exige une réévaluation des anciens récits et l’établissement de partenariats véritablement collaboratifs. Cette nouvelle ère promet à l’Afrique de prendre sa place en tant qu’acteur puissant et indépendant sur la scène mondiale si elle est capable de négocier ensemble.
Références
Ayisi, E. (2019). L’économie du Ghana : An Overview’. SAGE Publications. (Contexte général sur l’économie du Ghana et la gestion des ressources).
Brautigam, D. (2009). The Dragon’s Gift : The Real Story of China in Africa » (Le cadeau du dragon : la véritable histoire de la Chine en Afrique). Oxford University Press.
Castles, S. (2010). Comprendre les migrations mondiales ». Palgrave Macmillan. (Contexte général sur les dynamiques migratoires).
Cheru, F., & Obi, C. (Eds.). (2010). L’essor de la Chine et de l’Inde en Afrique : Challenges and Opportunities ». Zed Books.
Kragelund, P. (2008). Le retour des donateurs ? Aid and Power in the 21st Century. Development Policy Review », 26(6), 707-724.
Lynch, C. (2023, 14 mars). Alors que le Mali se tourne vers la Russie, la France regarde ailleurs dans le Sahel. Politique étrangère. (Exemple spécifique de changement d’alliances de sécurité).
Moss, T. J., et Subramanian, A. (2021). Chine et dette africaine : rééquilibrer la relation ». Centre pour le développement mondial. (Contexte sur les préoccupations relatives à la viabilité de la dette).
Özcan, G. B. et Akgün, B. (2012). La géopolitique changeante de l’Afrique : Un nouveau rôle pour la Turquie ? Journal of Balkan and Near Eastern Studies, 14(4), 515-531.
Transparency International. (2022). Rapports sur l’indice de perception de la corruption. (Contexte général des problèmes de gouvernance et de corruption en Afrique).
Whitfield, L. (Ed.). (2011). La politique de l’aide : Stratégies africaines pour traiter avec les donateurs ». Oxford University Press.