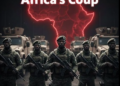Madagascar est une île de l’océan Indien. Située au large de la côte sud-est de l’Afrique, elle est la quatrième plus grande île du monde, le deuxième plus grand pays insulaire et le 46e plus grand pays. Madagascar a récemment été plongée dans la tourmente politique. Ces dernières semaines, la jeunesse de ce pays de l’océan Indien, frustrée par les pénuries chroniques d’eau et d’électricité, est descendue dans les rues d’Antananarivo pour protester contre l’administration du président Andry Rajoelina. Pour beaucoup, le point de bascule n’était pas seulement le délabrement des infrastructures, mais aussi l’indifférence et la corruption perçues par le gouvernement. Ce qui a commencé comme un mouvement en ligne sous la bannière Gen Z Mada, s’est rapidement transformé en un soulèvement national qui a attiré des milliers de personnes dans les rues.
L’étincelle est venue lorsque deux éminents politiciens de l’opposition ont été arrêtés pour avoir planifié une manifestation pacifique contre la Jirama, l’entreprise publique de services publics, dont l’inefficacité symbolise depuis longtemps la faillite de l’État (BBC News, 2025). Leur détention a été perçue comme une tentative de faire taire la dissidence légitime, galvanisant l’indignation du public et ralliant de jeunes activistes derrière le mouvement Gen Z Mada. Pendant des semaines, les manifestants ont exigé la démission de Rajoelina, l’accusant de mal gérer l’économie et de ne pas s’occuper des difficultés quotidiennes.
Malgré les efforts du gouvernement pour réprimer le mouvement – y compris une répression violente qui a fait au moins 22 morts et plus de 100 blessés, selon un rapport de l’ONU – l’élan des manifestants s’est avéré imparable (Reuters, 2025). L’énergie du mouvement mené par les jeunes, amplifiée par les médias sociaux, a reflété d’autres soulèvements de l’ère numérique à travers l’Afrique, du #EndSARS au Nigéria à la révolution menée par les jeunes au Soudan.
Quand l’armée rejoint les manifestants
La trajectoire des manifestations a changé radicalement lorsqu’une unité de l’armée – les forces d’élite CAPSAT – s’est jointe aux manifestants. Leur commandant, le colonel Michael Randrianirina, a déclaré que l’armée se rangeait du côté du peuple et qu’elle superviserait une période de transition. Peu après, le parlement malgache a voté la destitution du président Rajoelina, qui a fui le pays alors que les soldats défilaient dans la capitale.
Dans une tournure dramatique des événements, Randrianirina a prêté serment en tant que président de transition à la Cour constitutionnelle d’Antananarivo, promettant de restaurer la stabilité et d’organiser des élections dans les deux ans (Reuters, 2025). « Aujourd’hui marque un tournant historique pour notre pays », a-t-il proclamé, s’engageant à « travailler main dans la main avec toutes les forces vives de la nation pour rédiger une belle constitution » et à « réformer en profondeur » le système de gouvernance du pays (BBC News, 2025).
Pour beaucoup de gens dans la rue, cela ressemblait à une victoire – un triomphe générationnel contre la corruption et la négligence. Pourtant, sous la jubilation, le malaise s’est installé. La révolution des jeunes avait-elle été cooptée ?
Les échos du passé : Le cycle des coups d’État à Madagascar
Pour les observateurs qui connaissent l’histoire politique de Madagascar, ce moment semble étrangement familier. Le pays a connu plusieurs coups d’État et mutineries depuis son indépendance de la France en 1960. Ironiquement, Rajoelina lui-même est arrivé au pouvoir par un coup d’État soutenu par l’armée en 2009, avec l’appui de l’unité CAPSAT dirigée aujourd’hui par Randrianirina (France24, 2025).
Ce schéma – des « sauvetages » militaires déguisés en révolutions populaires – fait craindre que le soulèvement de la génération Z ne devienne un nouvel épisode d’un long cycle de démocratie interrompue. Comme le note Le Monde (2025), de nombreux jeunes Malgaches craignent désormais que « leur révolution, née de la frustration et de l’espoir, ait été volée par des hommes en uniforme ».
Anatomie d’une révolution volée
Les signes de cooptation sont difficiles à ignorer. Alors que Randrianirina a promis des élections dans les deux ans, son accession au pouvoir est indéniablement le fruit d’une prise de pouvoir militaire. L’Union africaine et plusieurs gouvernements occidentaux l’ont déjà condamné comme un coup d’État, bien que la Cour constitutionnelle ait insisté sur la constitutionnalité de l’opération (AFP, 2025).
Dans l’euphorie de l’éviction de Rajoelina, rares sont ceux qui ont pris le temps de se demander si une véritable démocratie était rétablie ou simplement remplacée par un régime militaire sous un nouveau visage. Cela reflète une tendance plus large en Afrique où les citoyens frustrés, désespérés par le changement, accueillent souvent l’armée comme un sauveur – du Mali au Niger et au Burkina Faso (Foreign Policy, 2025). Mais l’histoire montre que de telles interventions n’aboutissent que rarement aux réformes promises.
La consolidation rapide du pouvoir par les militaires, associée à leur contrôle des médias d’État et des forces de sécurité, fait planer le spectre d’une dérive autoritaire. « Ce qui a commencé comme un réveil démocratique risque de devenir une révolution détournée », a averti un analyste dans The Guardian (2025).
Pourquoi la génération Z s’est révoltée
La jeunesse malgache, comme celle de toute l’Afrique, est confrontée à des réalités socio-économiques désastreuses. Près de 80 % de la population vit avec moins de 2 dollars par jour, tandis que le chômage et l’inflation continuent de grimper en flèche (Banque mondiale, 2024). Les services de base comme l’électricité et l’eau potable sont devenus un luxe.
Les médias sociaux sont devenus leur arme. Des espaces en ligne tels que #GenZMada sont devenus des plateformes pour exprimer leur colère, organiser des manifestations et exiger la transparence. Comme l’a rapporté Al Jazeera (2025), « le mouvement était moins axé sur l’idéologie que sur la dignité ». Leur cri de ralliement était simple : ils voulaient un gouvernement qui fonctionne – et non un gouvernement englué dans le favoritisme et les promesses vides.
Cet activisme numérique reflétait un changement de génération – de la résignation passive à l’engagement civique – qui remettait en question l’ancienne élite politique de Madagascar. Cependant, malgré leur courage, le manque d’infrastructure politique des jeunes les a rendus vulnérables à la manipulation par des acteurs puissants, y compris les militaires.
Mal nécessaire ou trahison démocratique ?
Les partisans de la prise de pouvoir soutiennent que le coup d’État était un « mal nécessaire ». Ils soulignent que le gouvernement de Rajoelina était devenu dysfonctionnel, que la corruption à la Jirama symbolisait une pourriture plus profonde et que les militaires n’ont agi qu’après des mois de doléances ignorées (Reuters, 2025). De ce point de vue, l’intervention de Randrianirina a permis d’éviter une aggravation du chaos et un risque d’éclatement de la société civile.
Cependant, l’histoire nous met en garde contre un tel optimisme. Les dirigeants militaires arrivent souvent au pouvoir en promettant des réformes, mais finissent par se retrancher. Les parallèles avec d’autres États africains – où les coups d’État ont commencé avec un zèle réformateur mais ont dévié vers l’autoritarisme – donnent à réfléchir. Comme l’observe France24 (2025), « les généraux qui promettent de sauver la démocratie finissent souvent par l’étouffer ».
Les premiers gestes du nouveau gouvernement – enquêter sur la Jirama, promettre une réforme constitutionnelle et courtiser la coopération russe – montrent à la fois l’ambition et le risque potentiel. La présence visible de drapeaux russes lors des manifestations et la rencontre de Randrianirina avec les diplomates de Moscou laissent entrevoir un changement des alignements géopolitiques, faisant écho aux modèles du Mali et du Niger (Le Monde, 2025). De tels mouvements peuvent aliéner les partenaires traditionnels de Madagascar, y compris la France et l’Union européenne, isolant davantage l’île sur le plan économique.
Conclusion : La révolution à protéger
Le soulèvement de la génération Z à Madagascar n’était pas une simple émeute ; il s’agissait d’un réveil, d’une protestation générationnelle contre des décennies de mauvaise gouvernance. Mais son détournement par les militaires montre la fragilité des révolutions populaires dans les sociétés où les institutions démocratiques sont faibles.
Cela souligne également l’absence d’une direction identifiée ou correctement structurée de ces manifestations spontanées, qui commencent d’abord sur les médias sociaux et se répandent dans les rues. C’est peut-être ce manque de leadership clair qui permet à un groupe organisé et bien structuré, comme l’armée ou l’une de ses unités, d’intervenir pour ne pas laisser un vide de leadership, évitant ainsi non seulement une crise constitutionnelle, mais aussi un chaos potentiel et l’anarchie.
Les promesses du colonel Randrianirina peuvent lui permettre de gagner du temps, mais les jeunes qui ont déclenché ce mouvement ne resteront pas silencieux s’ils sont à nouveau trahis. Comme le dit si bien Reuters (2025), Madagascar est maintenant confronté à « un test entre la révolution et la régression ».
Que ce moment devienne un tremplin vers le renouveau ou un nouveau chapitre du cycle tragique des coups d’État à Madagascar dépend d’une chose : si les voix qui ont rempli les rues – la génération Z de Madagascar – se voient accorder un siège à la table pour façonner l’avenir de leur nation.
Références
– BBC News (2025). « Les manifestations de la génération Z à Madagascar renversent le président Rajoelina ».
– Reuters (2025). « Le colonel Randrianirina a prêté serment en tant que président de transition.
– Le Monde (2025). « La génération Z de Madagascar refuse de se laisser voler sa victoire.
– France24 (2025). « De la contestation au coup d’État : Le retour de l’armée au pouvoir à Madagascar ».
– Politique étrangère (2025). « La génération Z de l’Afrique et le piège militaire ».
– Al Jazeera (2025). « La génération numérique s’élève contre l’État défaillant à Madagascar ».
– Banque mondiale (2024). Aperçu du pays Madagascar.